Troisième homme et troisième Eglise
Les éditions Odile Jacob réimpriment l’article fameux « Le troisième homme » publié à la fin de 1967 dans la revue Christus par l’alors père François Roustang s.j., augmenté d’un historique d’Etienne Fouilloux et d’une étude sociologique de Danièle Hervieu-Léger.
Etant alors proche du père Maurice Giuliani, fondateur de Christus, et ayant connu par lui François Roustang, j’avais prêté attention à cet article lors de sa parution ; le père Denis Huerre, abbé du monastère, très sensible à l’aspect humain de la vie chrétienne, l’avait remarqué aussi et nous en avions parlé. Mon sentiment à la lecture était que ce texte sonnait juste. Je dis « sentiment », car je n’étais pas alors en mesure d’argumenter cette adhésion spontanée, d’identifier les passages plus importants ou plus discutables, de comprendre pourquoi exactement ce texte mettait le feu aux poudres chez les lecteurs, mais aussi chez les responsables de la revue. Le départ de l’auteur, qui quittait la Compagnie de Jésus peu de temps après, avait refroidi un peu mon consentement spontané ; pourtant je n’ai jamais cessé de me reporter à ce texte, et je l’ai encore cité dans mon Petit Essai sur le pape François récemment publié.
Le « troisième » homme survenait dans l’immédiat après-Concile après le « premier », conservateur réticent à l’aggiornamento conciliaire et après le « second », gagné à la réforme et impatient de la voir mise en œuvre. Ce troisième homme, que François Roustang repérait parmi ses amis et connaissances, était ailleurs. Le Concile l’avait fait sortir en quelque sorte des rails qu’il avait lui-même tracés. On dirait peut-être : le Concile lui avait permis d’être homme, simplement. Cela se traduisait certes par des mises en question théoriques, mais surtout par des pratiques différentes. Roustang citait la réconciliation, démarche de vérité envers quelqu’un : sa femme, un ami… créant une atmosphère neuve dans les rapports humains, au sens le plus large, mais indépendamment d’une accusation dans un confessionnal. Il citait aussi la sexualité et la manière de l’aborder : « comprendre et respecter l’autre, sans lui imposer un poids qu’il ne peut porter, en reconnaissant le désir de l’autre dans la lucide acceptation progressive du sien propre », ici en marge non du confessionnal mais d’un magistère extérieur (563). Venait ensuite la question de la liturgie et de l’Eucharistie, le passage à la langue vulgaire dévoilant le caractère suranné des mots et des rites, leur incapacité à créer ce pourquoi ils étaient faits : une communauté.
En somme, ce troisième homme, chrétien convaincu et disciple de Jésus-Christ, est atteint par ce qui lui semble le manque de pertinence humaine profonde dans les doctrines ou les pratiques communes dans l’Eglise, jusque dans ses récentes mises à jour. Ainsi ces chrétiens de type ‘troisième homme’ « se sentent devenus plus proches de tous les hommes qu’ils croisent sur leur chemin. Ils ne jugent plus, ne se croient plus supérieurs ou détenteurs d’une vérité toute faite ; ils entreprennent de chercher avec les autres, avec tous ceux qu’ils côtoient sans distinction de croyance » (565). L’auteur ne cache pas le danger de dissolution de la foi lié à cette attitude nouvelle, mais il invoque aussi la mémoire de Jean XXIII, « l’écho étonnant de sa maladie et de sa mort », d’où naît un sentiment fraternel vis-à-vis de tous les hommes, d’où vient la perception d’une convergence entre eux au meilleur d’eux-mêmes. François Roustang conclut en invitant son lecteur à prendre garde à cette nouvelle catégorie de chrétiens ; il s’inquiète de ce que le clergé « ne paraisse guère préparé à entendre ce déplacement de la conscience chrétienne » (567).
Que peut-on retenir, cinquante ans après, de ce texte ? Je proposerais volontiers qu’il soit considéré comme une clef herméneutique, en 2019, qui ouvrirait une porte à la fois ancienne et nouvelle au Concile Vatican II. Il s’agit d’avoir de l’homme une vision positive : un homme majeur, en face de soi-même, des autres, du Christ, de Dieu lui-même. Un homme image de Dieu « principe de ses actes en tant qu’il a sur eux le libre arbitre et la puissance »[1], un homme donc qui discerne, décide et agit, mais aussi qui écoute et répond, qui demande pardon et qui pardonne. Et donc un Christ, qui, venant en ce monde, écoute la Parole de Dieu son Père et y répond par ses choix, par son temps, par sa mort, indiquant ainsi la figure de Dieu : Celui qui crée par sa Parole, et aussitôt s’adresse, demande, attend, accompagne, pardonne, ressuscite. Et, s’il s’agit de l’Eglise, il faut réinterpréter le double discours de la liturgie et de l’autorité à la lumière de l’Homme majeur, du Christ donné à la Parole, et de Dieu interlocuteur sublime. Le temps ne serait-il pas venu de reprendre tout le Concile à cette lumière de l’homme ? Ou encore : tout ce qui est bon et durable dans ce qui s’est pensé et fait depuis le Concile ne vient-il pas de là ?
Ou, pour dire les choses autrement : l’avènement du troisième homme est contemporain de ce qu’on pourrait appeler « l’Eglise période III ». Il y a eu en effet la période I, durant laquelle la communauté naissante des disciples a dû se situer par rapport au judaïsme, dont elle sortait, et du monde culturel gréco-latin, indifférent parfois hostile, qui était le sien et où elle avait à vivre. La période II a commencé avec le Concile de Nicée et ceux qui ont suivi. On a peu à peu posé les bases d’une doctrine de Dieu, de son Christ, de l’Esprit ; puis une vision du salut dominée par la question de la rémission des péchés moyennant le sacrifice de la Croix, de la relation par conséquent entre la liberté et la grâce ; simultanément enfin une vision de la société tant civile que religieuse affrontée au problème des pouvoirs. Cette période a duré, moyennant progrès et régressions, sainteté, abus et réformes, jusqu’au 1er Concile du Vatican et ses décrets sur la Foi (Dei Filius) et sur l’Eglise (Pastor aeternus). Le Concile Vatican II ouvre sans doute une troisième période. Il n’est pas un concile de réforme mais d’instauration. Comme si tout ce qui avait précédé avait libéré une vision plus profonde, c’est-à-dire plus divine et plus humaine à la fois, qu’on pourrait résumer par cette sentence : « Dieu est amour et il est permis d’être homme ».
[1] Saint Thomas d’Aquin, Somme théologique, Ia-IIae, Prologue.




























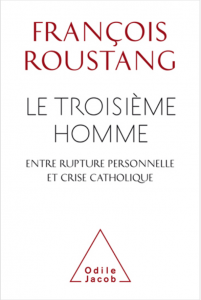
 Area personale
Area personale











